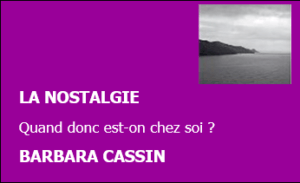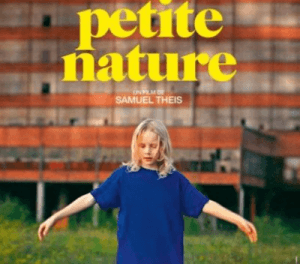de Mohammad Rasoulof[1]
Dans Les graines du figuier sauvage, l’accession tant espérée d’Iman au poste de juge d’instruction, dernière marche avant la place de juge d’un tribunal révolutionnaire, coïncide avec les premières secousses d’un mouvement de soulèvement de femmes iraniennes, qui prendra bientôt le nom de “Femme, vie, liberté”. Le film met en scène un vacillement intense en matière de repères et de places de chacun dans les rapports de domination (notamment hommes / femmes), se jouant à trois niveaux au moins : la société iranienne dans son ensemble, traversée par de vifs mouvements de révolte, la vie d’une famille bouleversée par l’évolution professionnelle du père et ses conséquences et les effets que cela induit sur chacun des membres de cette famille, tous impactés à leur manière. Niveaux inévitablement intriqués et dont le film ne cesse de montrer les interconnexions.
S’il n’est pas d’autorité sans sa contestation [Saül Karsz], il est des formes d’autorité et des formes de contestation qui connaissent des mutations, parfois lentes et progressives, parfois plus soudaines. Il importe de rappeler que les révolutions sont avant tout des processus, plus ou moins contradictoires, rarement linéaires. Ceux-ci connaissent stagnations, voire enkystements mortifères, mais aussi accélérations, éclats, sursauts provoqués par la rencontre entre un évènement (ici l’exécution d’une femme condamnée pour port de vêtement inapproprié) et l’état des rapports de force là où se déroule l’évènement en question.
Une histoire de vacillement, donc. Le film donne à voir de nombreuses scènes où un sujet, confronté à un choix, à une nécessité de se positionner, devra basculer d’un côté ou de l’autre : laisser ou non dormir une amie de sa fille à la maison, la soigner ou non lorsque cette dernière aura été grièvement blessée, signer ou non une ordonnance d’exécution, avouer ou non qu’on a dérobé une arme… Et c’est l’un des bienfaits paradoxal des périodes de bouleversement de repères : ne tenant plus pour naturel un état des choses, tout un chacun est sommé de se positionner explicitement. L’évolution progressive de la mère est à ce titre passionnant qui, femme dévouée à la carrière de son mari et aux bienfaits qu’elle en retire en matière de confort matériel et de prestige social, va être frappée (aux divers sens du terme) par les réactions brutales de son mari (symbole des forces conservatrices) et opérer un rapprochement progressif avec ses filles.
Le dénouement du film, à forte dimension métaphorique, se déroule dans les vestiges d’une ville désaffectée bien qu’encore majestueuse. Peu à peu une sororité naissante semble se tisser et les trois protagonistes féminines vont converger pour agir au sein et sur un certain rapport de domination, incarné ici par le rapport au père/mari. Figure qui, au terme d’une sorte de course poursuite haletante bien que presque enfantine, va choir, être ensevelie et désarmée (dans cet ordre). La fin d’une certaine domination ? Certainement pas, mais une étape vers d’autres possibles, de nouvelles voies à explorer, à conquérir.
Ce film prodigieux montre combien certaines contestations de certaines formes d’autorité sont des processus complexes, non dénués de contradictions, d’ambivalences. Traiter avec cette rigueur d’une telle période est inévitable pour éviter les oppositions binaires en termes de bons et de méchants, et par là tenter d’en comprendre quelque chose.
Sébastien Bertho – décembre 25
[1] Ce film tient son origine d’une période où le cinéaste était incarcéré du fait de ses prises de positions au sein de ses précédents films. Ce dernier long métrage a été tourné dans la clandestinité, au péril de la sécurité, sinon de la vie des différents protagonistes qui y ont contribué.